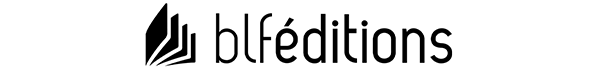Cet article est le premier chapitre du livre De Colmar à Kaboul de Ariane Geiger Hiriart.
Le petit Cessna rouge et blanc de l’aéro-club de Colmar descendait doucement en cet après-midi ensoleillée de mai 1974. J’avais vingt-six ans. Le pilote avait largué son lot de fous volants toute la journée… Je faisais partie du dernier stick de parachutistes et m’apprêtais à faire mon cinquième saut en commandé. En effet, le moniteur, satisfait de mes progrès, m’avait autorisée à concrétiser mon rêve: sauter sans SOA. J’écoutais consciencieusement ses conseils: «Ariane, tu ne te presses pas pour tirer la poignée. Nous allons monter à 1 200 mètres, tu as tout ton temps. Cambre-toi bien pour te stabiliser dans l’air, lève la tête et regarde l’avion. Ensuite, compte doucement trois secondes et tire la poignée. Si tout se passe bien, demain je te passe à cinq secondes de chute ! ».
Waouh! Pour moi, c’était le pied! J’étais épuisée par cette journée d’entraînement, mais enthousiasmée par ce sport que j’aimais énormément et qui engloutissait toutes mes économies.
Je saute donc… et quitte l’avion sans problème. Je me cambre, mets mes bras en croix, relève la tête et regarde mon moniteur qui étire un sourire lumineux. Je suis une élève appliquée et compte doucement les secondes: «001, 002, 003…» comme on me l’a appris. Je ramène les deux bras vers l’avant et, avec ma main droite, comme il se doit, j’attrape la poignée du parachute et la tire. À l’inverse des quatre sauts du matin avec une poignée factice, rien ne se passe.
Ma poignée ne bouge pas, mon parachute reste dramatiquement fermé. Je bascule dans le vide et n’arrive plus à me stabiliser. Je tourne comme un pantin désarticulé et j’aperçois la terre, le ciel, la terre, le ciel, en boucle.
Je m’affole et comprends que je suis en train de tomber à environ 200 kilomètres à l’heure vers un sol qui se rapproche de moi à une vitesse vertigineuse. J’ai très peur, je panique. Je vois le vert du terrain et le beige de la terre se mélanger. Je pense que je vais m’écraser. Des frissons de frayeur courent le long de ma colonne vertébrale. Je suis affolée, je descends si vite! La terre m’aspire, je sais qu’elle va bientôt m’engloutir. Je suis parfaitement consciente de ma mort toute proche, elle est inéluctable. Pourtant, je me bats encore pour tenter quelque chose… c’est trop bête !
Je pense enfin à mon parachute de secours collé à mon ventre. Il va me sauver, j’en suis sûre. Je tire sa poignée, mais là aussi : impossible, rien ne se passe. À cet instant précis, je suis certaine que je vais mourir, parce que j’ai perdu beaucoup trop de temps. Je suis maintenant à environ 400 mètres du sol. Je sais que si mon pépin ne s’ouvre pas immédiatement, je m’écrase : la voile du parachute n’aura plus assez de distance pour se déployer. J’aperçois les détails des herbes du terrain d’atterrissage, les traces de pas sur le chemin de terre. Tout devient énorme, monstrueux.
Avec l’énergie du désespoir, je tire encore une fois, avec violence, sur la poignée du ventral. Je comprends que c’est mon ultime chance. Le sol n’est plus qu’à quelques mètres. L’air me porte, je suis face au ciel où mon regard se perd.
Finalement, après plusieurs tentatives, la poignée se débloque enfin! La voile salvatrice fuse devant mes yeux. Je suis pendue à mon parachute de secours. Le vent me pousse vers l’usine Timken dans la zone industrielle de Colmar. Je m’aperçois avec horreur qu’entraînée par un vent d’est, je me dirige tout droit vers une grande cheminée fumante. Une frayeur affolante me saisit. J’attrape les suspentes de mon ventral et tire de toutes mes forces pour m’éloigner du cratère brûlant. Paradoxalement, en s’ouvrant si tard, mon parachute m’a permis d’être assez basse pour l’éviter et m’a sauvée de mourir grillée.
J’entends tout d’un coup un drôle de bruit: c’est ma tête, protégée du casque en métal, qui résonne en cognant sur le premier toit où j’ai atterri sur le dos. Je ne maîtrise rien, me laisse aller et ferme les yeux. Le deuxième bâtiment est si rapproché de l’autre que je roule sur ce second toit, sans même m’en apercevoir. La voile du parachute s’accroche alors à une petite cheminée d’aération et stoppe ma chute. Je me retrouve pendue, bien verticale, à dix centimètres du sol dans la cour de l’usine.
Mes copains du Para-club, qui avaient suivi toute la scène, pensaient me trouver morte. Un moniteur sauta dans sa voiture et arriva à toute allure. Lorsqu’il me trouva, je crois bien qu’il frôlait la crise cardiaque. Il était livide et n’arrivait pas à parler. C’était une «sacrée chance» ou pour certains, un « vrai miracle ». À l’époque, je ne croyais ni à Dieu ni à diable. J’étais contente d’être en vie, c’est tout.
Jacques, un des membres du club, qui n’était rien de spécial pour moi en ce temps-là, m’a avoué plus tard avoir soupiré: «Cela aurait été dommage, car je ne l’ai pas encore draguée!», avant de monter flegmatiquement dans l’avion!
Beaucoup d’années ont passé depuis cette expérience marquante autant que terrifiante. Si, à l’époque, je n’ai même pas eu le réflexe de me tourner vers Dieu pour le remercier de m’avoir gardée en vie, aujourd’hui, je sais que sa volonté était que je ne meure pas ce 13 mai 1974. Alors j’imagine un ange fendant l’espace à la vitesse bien supérieure à la lumière, se frayant un chemin entre les galaxies pour arriver jusqu’à moi qui tombais vers une mort certaine. Rien ne s’oppose à imaginer qu’un doigt gracile, enrobé de poussière d’étoiles, a fait sauter la poignée récalcitrante et a libéré la voile de mon parachute de secours. Cet envoyé du Seigneur m’a sauvé la vie, sur ordre du Très-Haut, juste à temps.

Cet article est un extrait du livre De Colmar à Kaboul de Ariane Geiger Hiriart.Quand la souffrance débouche sur un chemin de vie